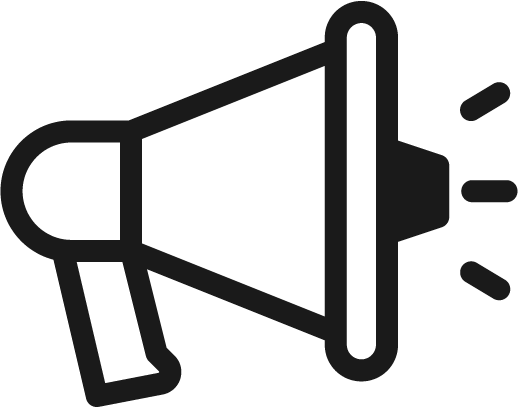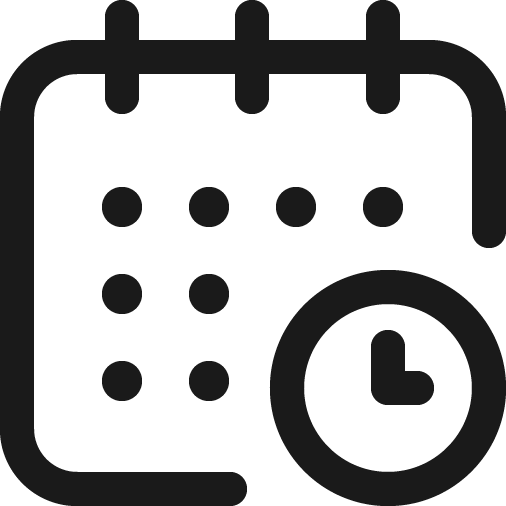L’exercice de l’art dentaire peut être opéré sous des formes multiples. Il n’existe pas de scénario standard qui puisse s’appliquer à tous les cas de figure rencontrés. L’essentiel est de pouvoir anticiper et de se projeter dans son futur mode d’exercice.
La fiscalité a elle aussi son mot à dire. En effet, les choix opérés, peuvent avoir une incidence à long terme.
Exercice en solo ou en groupe ?
Sur le plan juridique, il est souvent possible de faire évoluer son mode d’exercice en partant d’un exercice de type individuel vers un exercice en groupe.
Vous pouvez tout à fait démarrer votre vie professionnelle en choisissant le statut de l’entreprise individuelle, puis greffer sur celui-ci une participation dans une Société Civile de Moyen (SCM).
Ou bien, dans la mesure où vous souhaiteriez avec vos associés n’avoir qu’une seule structure d’exercice, vous pourriez tout à fait apporter ou céder votre fonds libéral à la structure commune choisie : par exemple, une société d’exercice libéral.

Se restructurer en France
Le droit français offre la possibilité de se restructurer assez aisément. Il faut naturellement bien penser en amont les incidences fiscales et sociales qui peuvent en découler mais le passage de l’exercice en solo vers l’exercice en groupe reste, dans bien des cas, généralement réalisable.
En pratique, deux régimes au niveau fiscal trouvent à s’appliquer :
• le régime de l’apport
• le régime de la vente
Grâce à ces deux régimes, qui impliquent des conséquences radicalement différentes, vous pourrez facilement muter votre mode d’exercice.
En résumé, le régime de l’apport, qui repose sur l’article 151 octies du CGI (Code Général des Impôts), permet de reporter l’imposition sur les plus-values constatées lors du passage en société.
Ainsi votre restructuration juridique n’a pas d’impact fiscal au moment du passage en société : vous ne payez pas l’impôt sur le revenu sur les plus-values relatives au transfert de propriété de votre fonds libéral (patientèle et matériel) à la société, réceptacle de votre outil de travail.
Mais comme l’administration fiscale ne connaît pas les termes « libéralité » et « gratuité », vous avez déjà dû le constater, l’impôt sera payé plus tard, lors de la vente du fonds libéral par la société ou lors de la cession des parts, avec l’application éventuelle de certains mécanismes d’exonération.
Dans le cas de la vente, qui vous permet comme la technique de l’apport, de changer de mode d’exercice, de passer d’un exercice individuel à un exercice en société, la fiscalité est quasi immédiate : les plus-values constatées par l’exercice de N entraîneront le paiement de l’impôt sur le revenu en N+1.
Au moins les choses sont claires, pas de plus-value latente, pas d’épée de Damoclès sur la tête du contribuable que vous êtes.
Exercice en groupe, quel degré d’indépendance conserver ?
Les chirurgiens-dentistes et orthodontistes appartiennent à la catégorie des professions libérales. Et dans le vocable « libéral », il y a l’adjectif « libre ». L’attachement à l’indépendance est souvent bien marqué et constitue l’ADN, la marque de fabrique, des « indépendants » que nous sommes.
Plus on avance dans l’âge, plus on se rend compte, qu’abriter sous le même toit, au sein de la même entité juridique, des hommes et des femmes, aux spécialités diverses, ayant des différences d’âge, parfois importantes, des visions et des stratégies plurielles, s’avère être compliqué… Surtout dans la durée.

Au commencement, tout est merveilleux, puis le leadership des uns et des autres vient à s’affirmer, poussant de jeunes associés détenteurs d’une très faible partie du capital social, à vouloir voler de leurs propres ailes ou des praticiens confirmés à vouloir regagner leur indépendance, en raison de fortes tensions au sein de l’équipe.
La fixation des rémunérations des praticiens, le choix des investissements à opérer, les décisions en matière de gestion des ressources humaines peuvent être des pommes de discorde entre les associés.
Le règlement intérieur aura alors vocation à mettre de l’ordre au sein de cette organisation et rappeler à la raison le(s) frondeur(s).
La SCM, si souvent décriée, constitue néanmoins un compromis.
Chacun des associés conserve la maîtrise de son niveau d’activité et n’a pas de leçon à recevoir de ses confrères en la matière. À contrario au sein d’une même structure, la nécessité de couvrir des charges fixes communes, incite à des niveaux d’activité relativement homogènes pour la bonne entente générale.
Chacun reste libre d’investir ou pas dans certains équipements au cas où certains associés préfèrent faire des choix différents. Il en sera de même en terme d’embauche. S’il y a besoin d’un(e) assistant(e) supplémentaire, rien n’empêche de franchir le pas. Au sein d’une entité commune, il faudra l’accord des confrères.
Mutualisation des locaux et du plateau technique
Quant à la mutualisation des locaux et du plateau technique, elle s’opère « à la carte », en essayant de respecter au mieux la règle de base suivante : moins on en met en commun, mieux on se porte !
Vous devrez donc bien réfléchir à ce que vous souhaitez partager avec vos associés. Là aussi, le règlement intérieur devra être rédigé avec soin, afin de bien cadrer cette mise en commun.

En étant enfin associé d’une SCM, vous conserverez aussi la liberté de choisir votre statut juridique. Si l’exercice individuel correspond à vos attentes, vous pourrez poursuivre ce mode d’exercice au sein de la SCM.
Si vous souhaitez passer en société, de type SEL par exemple, celle-ci pourra aussi être associée de la SCM, sans contraindre votre partenaire d’opter pour le même type d’exercice vous.
La vie étant faite de compromis, moins vous serez amené à vous retrouver dans des situations nécessitant d’impliquer vos confrères, plus votre exercice sera serein et mieux vous en maîtriserez les tenants et les aboutissants.
Dentairement votre.
Julien Fraysse
Julien Fraysse vous propose une série de podcasts pour améliorer la gestion de votre cabinet dentaire. Pour les écouter, c’est ici !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Julien Fraysse !