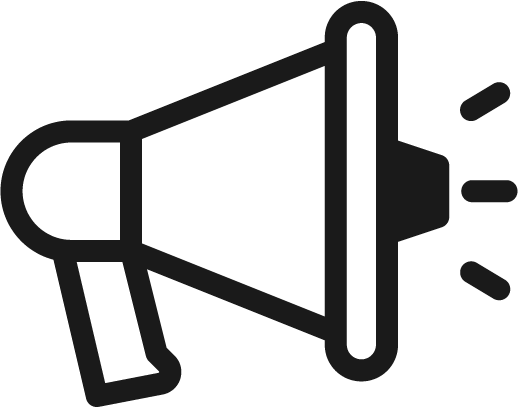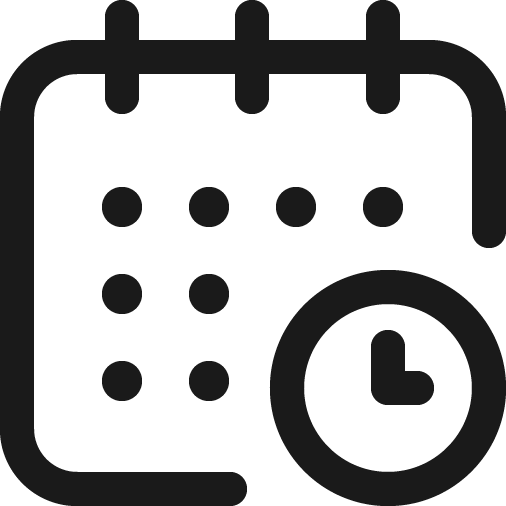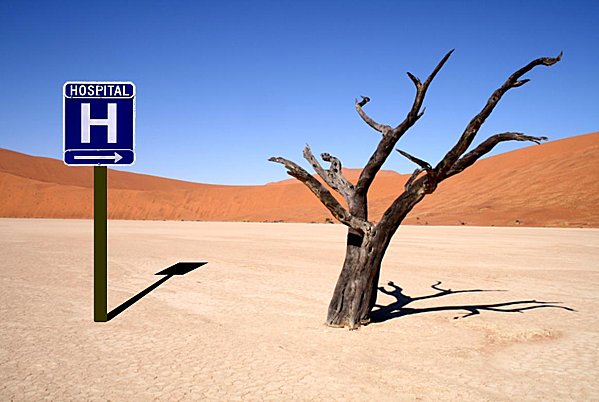Compte tenu de la mise en place à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vous avez intérêt à souscrire, si ce n’est déjà fait, ou à alimenter vos contrats d’épargne retraite Madelin d’ici le 31 décembre 2017 afin de profiter au maximum des déductions fiscales.
Le prélèvement à la source (PAS) va bien entrer en vigueur. Présenté le 15 novembre 2017 en Conseil des ministres, le dernier collectif budgétaire introduit officiellement ce nouveau mode de paiement de l’impôt sur le revenu (IR). À compter du 1er janvier 2019, l’IR sera prélevé directement sur les revenus d’activité. Avec le PAS, il n’y aura plus de décalage entre la perception des revenus et leur imposition, comme actuellement.
Pour éviter que les Français ne subissent une double taxation, les revenus perçus en 2018 ne seront pas, sauf dans le cas de revenus « exceptionnels », imposés en 2019. Revers de la médaille de cette année « blanche » fiscale : les déductions d’impôts ne seront pas, sauf cas exceptionnels, prises en compte. Ce sera le cas notamment des cotisations versées dans le cadre des contrats de retraite Madelin réservés aux travailleurs non-salariés (dont les professions libérales) et qui leur permettent de percevoir des rentes à compter de leur départ de la vie active.
Jusqu’à 72 572 euros de déductions
En revanche, les cotisations versées en 2017 sur les contrats Madelin pourront bien être déduites des revenus à déclarer au fisc en 2018. Vous avez donc tout intérêt à alimenter vos Madelin d’ici la fin de l’année.
Pour rappel, les cotisations peuvent être déduites à hauteur de 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ou, si le calcul est plus favorable, de 10% des revenus professionnels dans la limite de huit fois le PASS, majorés de 15% de la fraction comprise entre un et huit PASS. Le PASS ayant été fixé à 39 228 euros en 2017, les versements effectués cette année sur un contrat de retraite Madelin pourront être retranchés des revenus avec un « plancher » de 3 922 euros et un « plafond » de 72 572 euros !
Cotisations facultatives et rachats
Si vos cotisations obligatoires au Madelin ne vous permettent pas d’atteindre le plafond, vous avez toujours la possibilité d’effectuer des versements complémentaires facultatifs sur votre contrat. Ces versements supplémentaires ne doivent pas excéder 15 fois le montant des cotisations obligatoires. Ce qui laisse une grosse marge de manœuvre.
Vous pouvez également racheter des cotisations sur un Madelin. Le nombre d’exercices rachetable est égal à la différence entre la date d’affiliation aux régimes obligatoires de protection sociale du travailleur non salarié (RSI, CNAVPL…) et la date de souscription du contrat Madelin. Seule limite : ces versements ne permettent pas de racheter plus d’une année de cotisation par an, et ce pendant dix ans maximum.
Les cotisations facultatives et les rachats de cotisation peuvent également être effectués sur le contrat de retraite Madelin de votre conjoint collaborateur. En effet les époux, épouses et partenaires de PACS d’un professionnel libéral qui travaillent pour le compte de ce dernier sans être rémunérés, ni posséder de parts au capital du cabinet sont autorisés à ouvrir un Madelin. Le plafond de déductions est intégré à celui du libéral.
Quid des versements effectués en 2018 ? (*)
S’il semble avéré que les versements effectués en 2018, ne seront pas, sauf cas exceptionnels déductibles du revenu professionnel imposable, plusieurs arguments militent pour maintenir les versements en 2018, notamment dans le cas de revenus exceptionnels.
De surcroît les sénateurs ont récemment déposé un amendement, qui s’il venait à être adopté, aurait pour effet de minorer les déductions fiscales ultérieures si les montants versés en 2018 étaient inférieurs à ceux de 2017 et 2019 (article AGEFI ACTIFS du 30/11/2017 : https://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/les-deputes-veulent-eviter-un-trou-dair-pour-79001).
En conclusion, en l’état actuel des débats, il apparaît opportun non seulement d’ouvrir et/ou verser sur son contrat d’épargne retraite Loi Madelin cette année… mais aussi l’année prochaine.
(*) sous réserve du vote du texte définitif par l’Assemblée Nationale
Cet article vous est proposé par La Médicale.